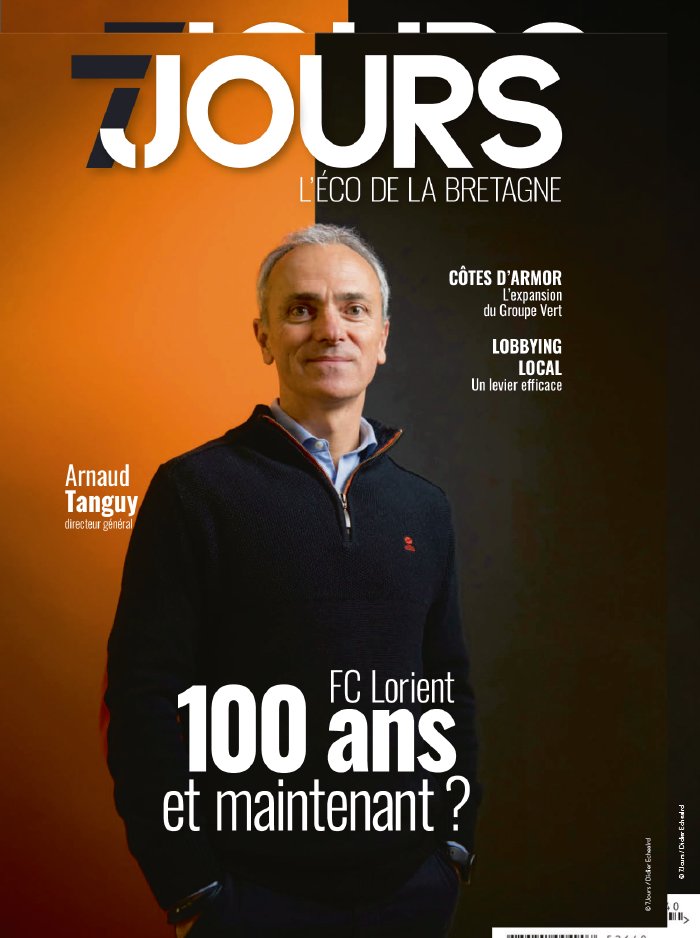Comme le souligne l’ADEME, les entreprises du secteur tertiaire, agricole et industriel sont avantagées par rapport à l’immobilier d’habitation dans la faisabilité technico-économique de leurs projets d’autoconsommation (avis de 2008 sur l’autoconsommation collective). En effet, la plupart des projets d’autoconsommation reposent sur des solutions de production par intermittence comme les cellules photovoltaïques en toiture. Or, contrairement aux immeubles du secteur résidentiel, dont les occupants consomment de l’énergie tôt le matin et en soirée, c’est-à-dire lorsque l’installation photovoltaïque ne produit pas, les besoins en consommation énergétique de l’immobilier d’entreprise sont synchronisés avec le temps solaire.
Sur le plan juridique, le régime de l’autoconsommation s’inscrit dans la droite ligne des tendances actuelles du droit de l’énergie, qui visent à promouvoir la transition énergétique au travers d’une production laissant une part de plus en plus significative aux énergies renouvelables. Figure centrale du dispositif, le consommateur est appelé à prendre une part active de ce mouvement en devenant un « client actif » qui a le droit de produire sa propre énergie et « d’agir sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires » (notion consacrée en 2019 en droit de l’Union Européenne, dans la Directive 2019/944 relative au marché intérieur de l’électricité).
Il en résulte que l’objectif général recherché par le législateur depuis 2015 est d’offrir un cadre incitatif à la mise en place de solutions d’autoconsommation, en évitant les contraintes réglementaires ou tarifaires trop lourdes (l’entrée de l’autoconsommation en droit français résulte de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015). Pour autant, l’élaboration d’un projet d’autoconsommation nécessite de maîtriser quelques concepts juridiques de base, chaque formule correspondant à un projet d’ingénierie fondamentalement différente. L’autoconsommation peut, en effet, être individuelle ou collective.
L’autoconsommation individuelle
Aux termes de l’article L. 315-1 alinéa 1 du code de l’énergie :
« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est so…